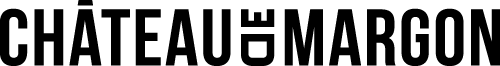Emergeant tel un îlot au milieu de l’océan de vignes, Margon tient ses maisons serrées autour de l’imposant château. Ce dernier est déjà mentionné en 1080, lorsque Pierre Alquier assiste à la donation que Marie, sa femme, et leurs enfants font de la paroisse de Cassan aux chanoines réguliers de St Augustin.
A la faveur de la Croisade des Albigeois, la terre de Margon,
siège d’une ancienne baronnie, passe sous la souveraineté du Roi
en 1221, alors que la province du Languedoc ne sera rattachée
à la France que 50 ans plus tard.


Cette particularité territoriale et politique a toujours été revendiquée par ses seigneurs qui ne manquaient pas de rendre hommage au roi à chaque nouveau règne et par ses habitants,
dotés d’un caractère peu accommodant, fidèles à la tradition
qui avait fait donner à leur commune le nom de « République
de Margon ».
Aux familles féodales Alquier, de L’Isle et d’Antignac, ont succédé à partir de la Renaissance, les Plantavit de la Pauze dans le négoce, puis à partir de 1719 les Le Moine dans la finance. Cette famille
est toujours propriétaire du château.

C’est un quadrilatère imposant avec quatre tours à ses extrémités. Elles sont réunies entre elles, d’un côté par un grand corps de bâtiment servant d’habitation (avec en son centre côté cour, une tour ronde servant d’escalier) et des trois autres côtés par des courtines (c’est-à-dire des passages permettant de faire le tour complet de l’édifice).



Ce sont des jardins réguliers de composition classique à la française avec le côté structuré du jardin à l’italienne. On y trouve des cyprès en colonne, des topiaires en lauriers sauce, des allées bordées de lauriers roses, des grenadiers à fruit ou à fleur, des oliviers taillés en tambour et une collection d’iris.









Les vignes sont indissociables de cette région. Celles, proches du château, figuraient déjà sur un compoix (cadastre) du XVIe siècle.
Leur culture est faîte aujourd’hui selon les critères de la charte terra vitis, dite culture raisonnée. Cela consiste à employer le strict minimum de produits de traitement.


Bordant le jardin, la cave est un long bâtiment du XVIIIe siècle prolongé par un hangar posé sur de gros piliers en pierre de taille. Elle a été entièrement refaite en 2004. Les deux rangées de cuve, en béton pour les vins rouges, en inox pour les vins blancs, sont terminées par le chais où le vin vieillit en barrique.



Profondément transformé au XVIe siècle il est agrandi à la fin du XVIIe en doublant les courtines.
Lors de la Révolution, en 1793, le château est mutilé, les toitures sont détruites et le chemin de ronde est rendu inutilisable.



C’est Jean de Plantavit qui, en 1682, « modernisa » les intérieurs en remplaçant les grandes cheminées « à l’antique » par des petites, des petites portes en fit des grandes, puis s’adressa à des « barbouilleurs » tel Pezet pour peindre murs et plafonds.

Puis c’est au début du XVIIIe siècle que les filles de René Le Moine continuèrent d’aménager les intérieurs et de les moderniser, avec la création de couloirs pour obtenir des chambres moins grandes et indépendantes, mais surtout avec le remplacement des cheminées gothiques par de moins imposantes et le remplacement des fenêtres à meneaux par des portes fenêtres dites à l’italienne.




Le château du Moyen-Âge est transformé à la Renaissance en demeure élégante. On greffe sur la structure médiévale, un décor gothique flamboyant avec de grandes fenêtres à meneaux et leurs encadrements terminés par des culots représentant des animaux fantastiques, des échauguettes en nids d’aronde et des petits parapets crénelés.


L’absence de mâchicoulis sur les chemins de ronde montre qu’ils sont davantage destinés au maintien d’une apparence militaire héritée des époques antérieures, qu’à une réelle défense rapprochée.
Des campagnes annuelles de restauration sont entreprises depuis 1981. En 2016 la façade sur le jardin a été restaurée.


C’est toujours Jean de Plantavit qui eut l’excellente idée, pour aller du salon au jardin sans avoir à traverser la rue, de la faire enjamber par des escaliers supportés par des voutes. Elles permettent, par dessous, le passage dans l’espace public par la rue des Banastes.
Puis c’est en comblant un fond de vallée et en déplaçant le ruisseau qui y coulait, qu’a été crée un véritable parc. Il est maintenant restauré depuis une trentaine d’années.